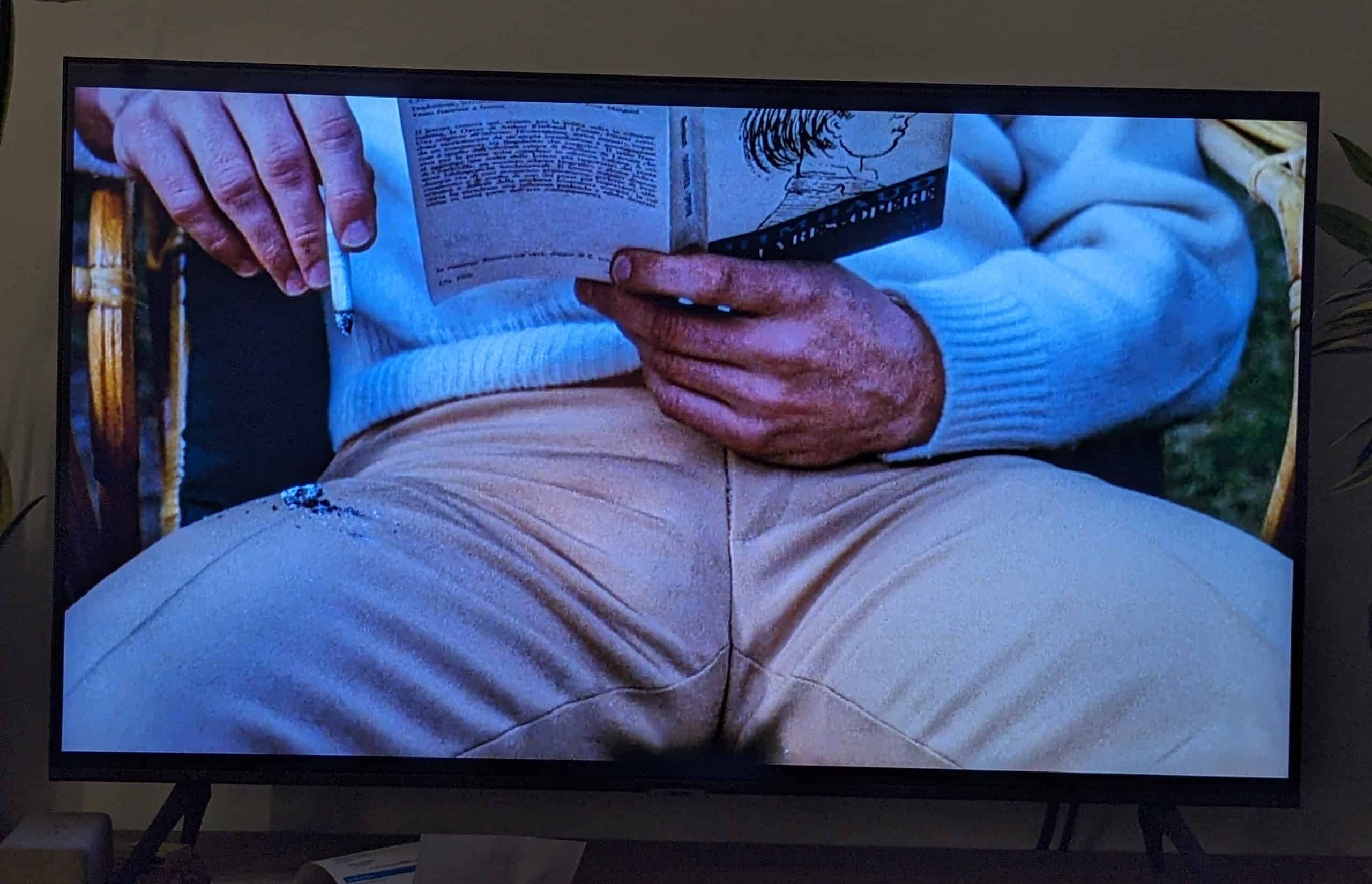Livre d’heures d’un purgatoire mécanique.
Qui sera notre Virgile ?
Paradis = zéro.
Personne à l’étage.
Après la pluie,
la Provence est un désert.
Au pied du Mont Ventoux,
Pétrarque est le nom qu’un élu illettré aura donné à une aire d’autoroute,
une déviation sans nulle indication d’itinéraire bis,
un chemin sans retour,
une voie où l’on avance à l’aveugle,
les yeux rivés sur le néant.
Villes bafouées,
passés sans souvenirs,
mémoires humiliées,
centres gérontologiques,
foyers d’accueil, avenirs moqués.
Exils en la terre crainte.
Tyrannie de la lâcheté.
Comment s’appelait-il ?
Qui ?
Ne te souviens-tu pas ?
Mais si, on aurait dit le nom d’une pizza.
Ou d’un joueur de foot, je ne sais pas.
Ah oui, Dante, c’est ça.
Déjà, l’intelligence artificielle a révélé sa vraie dimension politique :
proposer aux humains désemparés des contenus pour adultes.
Comment se fait-il, alors, que nous ayons l’air sans cesse plus puéril ?
Comme si,
à mesure que l’espérance de vie augmentait,
nous nous empêtrions dans une sorte d’enfance éternelle,
laquelle, dès lors, n’a plus rien à voir ni avec l’enfance humaine ni avec l’enfance de l’art,
mais avec une sorte de béatitude sans au-delà,
sans cesse recommencée,
chaque jour semblant renouveler l’éternité pour toujours.
Dans l’habitacle du véhicule,
à aucun moment,
je ne me sens en sécurité.
Au contraire,
et surtout quand je ne suis pas au volant,
je me crispe,
serre les mousses plastiques du siège entre mes doigts violacés,
me détournant de la route,
tâchant de ne pas voir la violence du danger,
l’imminence de la mort, son évidence.
Quand il m’arrive de croiser le regard d’autres automobilistes,
ou plutôt des passagers,
prisonniers comme moi de la carcasse,
je suis terrifié,
pris d’angoisses inconcevables.
Globules vides,
cellules où l’on nous tient enfermés,
au nom de la liberté,
telles sont nos voitures.
Fort heureusement,
toutes les ombres passent,
comme les automobiles :
en excès de vitesse.
La mort est en promotion sur l’étal du supermarché.
Et la vérité,
une ligne de code dans l’immense programme de nos vies insensées.
Tout cela ne veut rien dire,
et nous ne faisons même pas semblant.
Nous fonçons sur l’autoroute du désespoir,
l’autoroute du dérisoire ;
il n’y a pas de but au voyage,
pas de retour au pays,
pas de chez-soi,
rien que d’immenses et destructrices migrations :
partout, tout le temps, toujours plus de gens.
La vérité,
je le pourrais le cacher, c’est vrai,
je pourrais faire semblant,
mais ce n’est pas dans ce dessein que j’écris,
la vérité, c’est que tout cela me fait peur :
je veux voir la réalité telle qu’elle est,
mais la réalité me fait peur.
Qui sommes-nous pour consentir à vivre ainsi ?
Et comment se fait-il que personne ne se pose la question ?
Ne s’arrête,
ne tire le frein à main ?
Vampires dans les barils de pétrole, — le diable est une machine folle
Et folles, toutes les machines le sont.